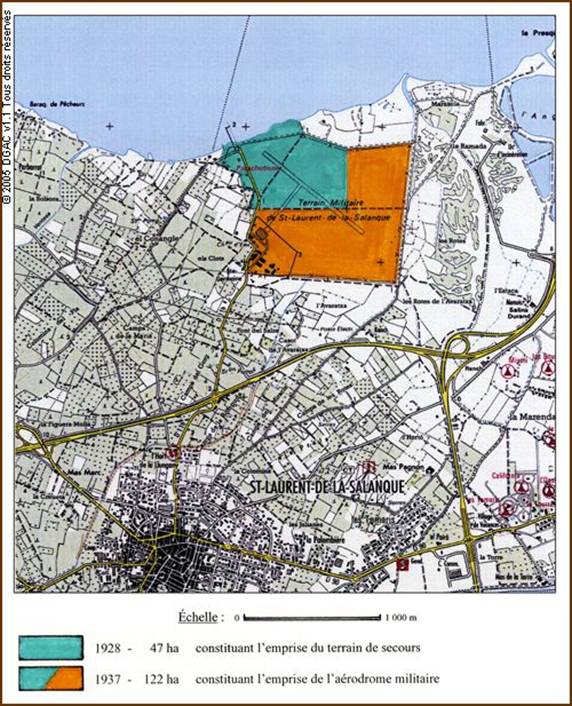LES AÉRODROMES DE LA CAMPAGNE DE
FRANCE DU GC III/6
Extraits de « L’Atlas historique des terrains
d’aviation de France métropolitaine 1919-1947 »
édité par la mission mémoire de l'aviation civile.
Les
hommes du GC III/6 - Historique officiel du GC III/6 - Livre de marche de la 5° - Livre de marche de la 6°
Page
d’accueil du site de François-Xavier BIBERT
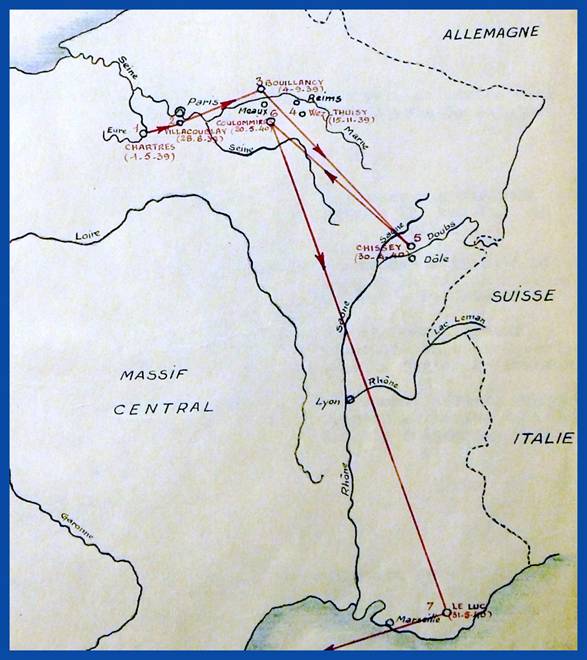
|
Base de départ en guerre |
|
|
(03/09/1939 - 15/11/1939) |
|
|
(15/11/1939 – 30/04/1940) |
|
|
(30/04/1940 – 20/05/1940) |
|
|
(20/05/1940 – 31/05/1940) |
|
|
(31/05/1940 – 18/06/1940) |
|
|
(18/05/1940 – 20/06/1940) |
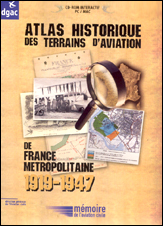 La
mission mémoire de l'aviation civile a édité en 2005, à partir des
travaux de Jean Sauter, ingénieur des Ponts et Chaussées, spécialiste
des Bases aériennes, un CD-ROM intitulé « Atlas historique des
terrains d’aviation de France métropolitaine 1919-1947 ».
La
mission mémoire de l'aviation civile a édité en 2005, à partir des
travaux de Jean Sauter, ingénieur des Ponts et Chaussées, spécialiste
des Bases aériennes, un CD-ROM intitulé « Atlas historique des
terrains d’aviation de France métropolitaine 1919-1947 ».
Ce CD-ROM classe tous les terrains du
XXe siècle selon trois critères ; terrains créés avant 1947 et disparus
depuis, terrains actuels créés avant 1947, terrains créés depuis 1947.
Pourquoi 1947 ? Parce qu’un arrêté
ministériel scella à cette date le sort de nombre d’aérodromes, certains ayant
été rendus impraticables par le conflit qui venait de s’achever, d'autres,
comme les terrains de secours, n'ayant eu qu'une existence éphémère.
Pour chacune des plateformes créées
avant 1947, le CD comporte un historique accompagné d'un plan de situation très
précis, sur lequel apparaissent les différentes étapes de l’évolution du
terrain. Les fonds de carte sont ceux de l’IGN.
Le CD comporte ainsi des données pour
près de 500 aérodromes, parmi lesquels bien évidemment ceux sur lesquels le GC
III/6 a été basé de septembre 1939 à juin 1940.
Les extraits ci-dessous sont présentés
avec l’aimable autorisation de la mission mémoire de l’aviation civile.
Aérodrome
militaire de CHARTRES - CHAMPHOL (Eure-et-Loir)
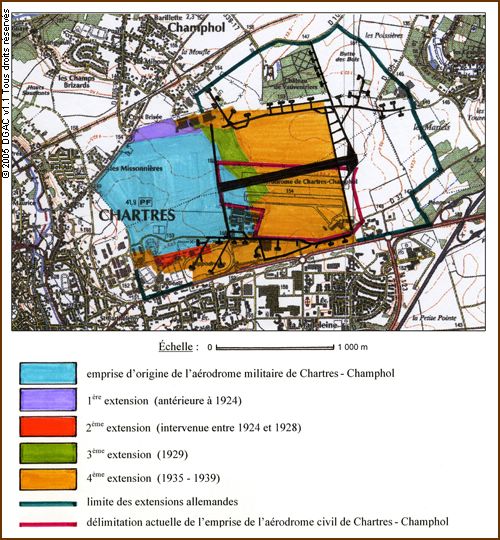
Le seul terrain d’atterrissage signalé
pour Chartres avant août 1914 par l’Aéro-guide de
l’Aéroclub de France était un champ de tir situé à proximité nord de la route
d’Angerville, à 4 km à l’est de la ville chef-lieu et à 2,5 km à l’est-sud-est
du futur emplacement de Champhol.
Non cité par la liste des aérodromes
militaires publiée par le Bulletin de la Navigation Aérienne d’octobre 1922,
Chartres - Champhol n’apparut en tant que tel que sur celle de janvier 1924.
Décrit, en octobre de cette même année, par les Instructions aéronautiques, il
n’en fait pas moins apparaître, au nord, une première extension d’emprise
(reportée par un aplat violet sur la carte, la configuration d’origine étant
indiquée en bleu).
La fiche modificative des Instructions
aéronautiques de février 1928 et le guide Michelin des aérodromes de 1935 -1936
permettent, pour la suite, de suivre l’évolution de la plate-forme jusqu’à ce
que, prenant le relais, les anciennes archives de l’Air nous informent plus en
détail sur l’importante quatrième et dernière extension intervenue avant juin
1940. C’est ainsi que, après avoir légèrement repoussé sa limite au sud entre
1924 et 1928 (aplat rouge sur le plan), le terrain s’est de manière plus
conséquente étendu une première fois vers l’est en 1929 (aplat vert sur le
plan). Le fait que ces extensions successives aient été au nombre de trois est
confirmé par une allusion faite aux dommages subis par les exploitants
agricoles lorsqu’il fut question, à partir de 1935, de compléter encore de 115
ha (aplat orangé sur le plan) la surface de l’aérodrome.
Ainsi est-ce en août 1935 que fut
définie en conférence sur place la configuration qu’il convenait de donner
désormais à la plate-forme. Les décrets-lois du 30 octobre 1935 étant
intervenus entre temps, le ministre de l’Air définit le 9 décembre à
l’attention de la chefferie du Génie du Mans, chargée de l’opération, la
procédure d’expropriation à engager.
Deux arrêtés préfectoraux avaient
déjà, quelques jours auparavant, autorisé l’administration militaire à occuper
temporairement les parcelles concernées. Ces deux arrêtés firent l’objet d’une
requête en Conseil d’État tendant à leur annulation, qui sera rejetée en
janvier 1938 au motif qu’il appartenait au Conseil de préfecture et non au
Conseil d’État d’être saisi en premier ressort.
Fait plus important, l’estimation des
Domaines, trop rapidement effectuée pour les besoins de la conférence d’août
1935 et avalisée par la suite par le ministre des Finances, fut largement
dépassée par les prétentions des 140 propriétaires et fermiers.
Le recours à l’expropriation ayant été
décidé par le ministre de l’Air en décembre 1936, les tractations reprises par
le Génie aboutirent finalement à ce que les acquisitions puissent s’engager sur
la voie d’un règlement amiable pour cause d’utilité publique. N’intervenant,
par contre, que pour 1 hectare, l’emprise d’un autre stand de tir appartenant à
une société qui, depuis 1911, offrait notamment ses services au 30ème
régiment territorial d’Infanterie et dont, par égards, il avait jusque là été sursis à l’acquisition, dut être expropriée
en juillet 1939.
Ayant pris possession des lieux, les
Allemands repoussèrent de manière importante les limites de la base (en bleu
sombre sur le plan) et dotèrent celle-ci d’une piste revêtue de 1 250 m x 80 m
et d’une voie périphérique en grande partie bétonnée, desservant elle-même
plusieurs aires de dispersion (les infrastructures allemandes sont reportées en
noir sur le plan).
L’aérodrome fut occupé successivement
par plusieurs unités américaines, qui rendirent aussitôt la piste utilisable
par tous leurs types d’avions en comblant les nombreux trous qui l’avaient
endommagée et en la prolongeant de 420 m à l’est au moyen de grilles sur
paillon. A leur départ, l’aérodrome fut repris par l’Armée de l’Air.
Définies en août 1946 par le ministre
des Travaux publics et des Transports, les parcelles réquisitionnées devant
être acquises furent modifiées en avril 1947 pour tenir compte de l’intention
annoncée par l’Armée de l’Air d’abandonner l’aérodrome que l’arrêté ministériel
du 6 février 1947 venait tout juste d’ouvrir sans
restrictions à la circulation aérienne publique.
Allant au-delà, le Conseil des
ministres prendra le 1er décembre 1948 la décision de principe de déplacer
l’aérodrome en raison du danger que son utilisation faisait courir à la
cathédrale de Chartres. Deux solutions seront alors envisagées, l’une
consistant à créer un aérodrome mixte à Sours, à 12
km au sud-est de Chartres, l’autre à établir l’activité civile sur le site de
Fontenay, à 5 km au sud-ouest et à aménager pour l’Armée de l’Air l’aérodrome
d’ Évreux.
Le coût de l’une ou l’autre de ces
deux solutions comme la préférence accordée par les collectivités locales au
maintien de l’aviation légère et sportive à Champhol – pour peu que puisse y
être définitivement rendue impossible la réapparition d’une activité
aéronautique militaire – conduiront à ce que soit d’abord retenu le principe
d’une bande unique dont l’axe, d’orientation N-E / S-O, serait calé en partie
est de l’ancienne emprise de manière à être le plus éloigné que possible de la
cathédrale.
Le souci de pouvoir accueillir à
Champhol une partie de l’activité d’entraînement des aérodromes de
Toussus-le-Noble, de Guyancourt et de Saint-Cyr comme celui de faciliter
l’urbanisation des quartiers est de Chartres conduiront toutefois, par la
suite, à ce que soit aménagée une seconde bande parallèle à la première selon
une direction d’axe réorientée.
Page
consacrée à l’histoire de l’aérodrome militaire de Chartres –BA 122
Plate-forme d'opérations de BETZ - BOUILLANCY
(Oise)
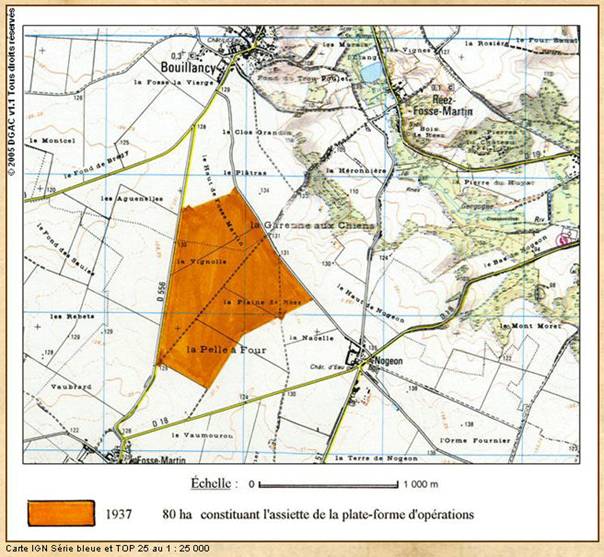
La décision ayant été prise de créer
une plate-forme d'opérations de 89 ha sur les territoires des communes de
Bouillancy et de Réez-Fosse Martin, les parcelles n'ayant pu être acquises à
l'amiable furent expropriées par ordonnance du président du tribunal civil de
Montdidier du 1er septembre 1937.
Le droit de pacage ayant été accordé à
un particulier en 1941 puis, en 1942, avec l'accord du secrétaire d'État à
l'Aviation, les Allemands ordonnèrent tous seuls en 1943 au maire de Réez-Fosse
Martin de prendre toutes dispositions pour remettre le terrain en culture.
Cette remise en culture ayant été
temporairement confirmée par le ministre de l'Air en janvier 1946, le ministre
des Travaux publics et des Transports - à qui venaient d'être transférées les
attributions du premier - prescrivit en septembre de la même année l'aliénation
des terrains constituant l'aérodrome.
Huit mois plus tard, il demanda
toutefois au service local des Ponts et Chaussées de surseoir à l'exécution de
sa précédente décision jusqu'à ce que soit mis au point et arrêté le plan
d'équipement aéronautique de la région parisienne.
Les baux de culture seront ainsi
reconduits d'année en année jusqu'en 1950. Ils céderont alors place à des
autorisations d'occupation temporaire qui, seules en fait applicables au
domaine public, permettaient que les preneurs ne puissent se prévaloir du droit
de renouvellement du bail après neuf années de location.
Le plan d'équipement aéronautique de
l'Oise ayant en 1950 prévu la présence près de Betz d'un aérodrome de catégorie
D, la situation domaniale de la plate-forme sera "provisoirement"
maintenue.
La plate-forme n'ayant pas reçu la
destination pour laquelle une partie des parcelles la constituant avait été
expropriée, les anciens propriétaires concernés tenteront en 1952 d'obtenir la
rétrocession de leurs biens. Accordé par un décret-loi du 8 août 1935, ce droit
ne s'exerçait toutefois plus, un délai supérieur à dix ans s'étant écoulé
depuis l'ordonnance d'expropriation.
Sur le point d'être abandonné en 1963,
après que les sites de Bailleau-sous-Gaillardon et de
Buno-Bonnevaux aient été jugés compatibles avec la circulation aérienne, la
création de l’aéroport projeté au nord de Paris placera aussitôt l'aérodrome de
Betz-Bouillancy en position de remplacer ceux qui allaient, par contre, se
trouver neutralisés.
Las de s'inquiéter du sort de
l'aérodrome, le ministère de la Défense renoncera en 1970 à en demeurer
affectataire. Faute alors de voir sa situation périodiquement évoquée,
l'aérodrome continuera machinalement d’être loué à de discrets exploitants
agricoles…
Voir
l’album des photographies de Joseph Bibert (GC III/6) du début de la guerre
Lire
« Pèlerinage à Bouillancy » - Visite des lieux et témoignages en 2009
Plate-forme d'opérations de REIMS - WEZ - THUISY
(Marne)
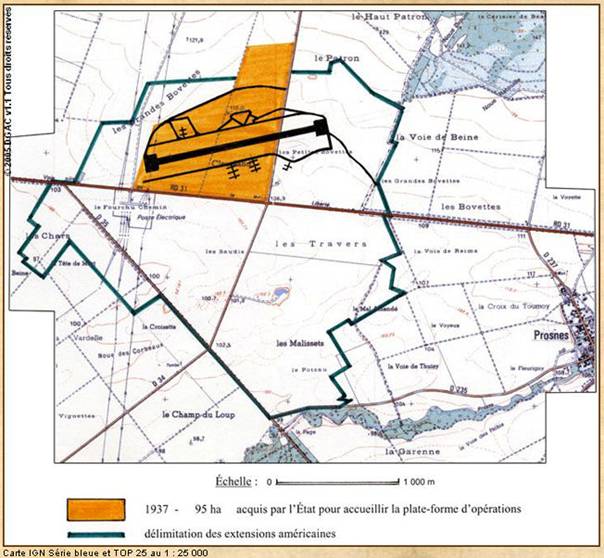
Situés en bordure nord de la R.N. 31
(actuelle R.D.31), immédiatement au sud du champ de tir aérien des
Monts-de-Champagne aménagé à la même époque, les 95 ha (aplat orangé sur l’extrait
de carte) destinés à servir d’assiette à la plate-forme d’opérations de Reims- Wez - Thuisy ont fait l’objet
d’une cession amiable à l’État aux termes d’un unique acte administratif du 8
mai 1936.
Utilisée par l’Armée de l’Air en mai
1940, elle le fut à nouveau, quatre ans plus tard, par les Américains. Ceux-ci
en repoussèrent les limites jusqu’à constituer une emprise de 545 ha (délimitée
en bleu sur le plan) partagée en deux parties sensiblement égales par la R.N.
31.
Maintenant l’activité aéronautique sur
la partie nord, ils construisirent sur celle-ci une piste de campagne de 1500 m
x 50 m, en feutre bitumé sur 1100 m en partie centrale et en grilles
métalliques sur chacune de ses extrémités (les infrastructures américaines sont
reportées en noir sur le plan).
Les Américains ayant quitté le camp de
Wez - Thuisy en octobre
1946, la Société nationale des surplus prit leur relève sur la quasi-totalité
de la partie située au nord de la R.N. 31. Pour le reste, le ministre chargé
des Transports prescrivit en février 1947 la levée des réquisitions.
Aucune décision n’ayant encore été
prise quant à l’avenir aéronautique du site, la situation du moment fit que
l’aérodrome rejoignit, à titre provisoire, la longue liste de ceux du
département de la Marne déclarés fermés à la circulation aérienne publique par
l’arrêté ministériel du 6 février 1947.
Estimée ne plus présenter d’intérêt,
ni pour l’Armée de l’Air ni pour l’Aviation civile, la plate-forme de Wez - Thuisy sera en septembre
1950 remise à l’administration des Domaines en exécution de la loi créant des
ressources nouvelles au profit du Trésor.
Échappant jusque là
à son aliénation, elle sera, sans réintégrer le domaine public aéronautique,
réaffectée en août 1955 à l’Armée de l’Air en vue de sa réutilisation à
échéance plus ou moins lointaine.
Finalement, le terrain de Wez - Thuisy sera restitué à
l’administration des Domaines en septembre 1964 puis vendu à la SAFER - Champagne-Ardennes en janvier 1969.
Terrain de secours de CHISSEY (Jura)
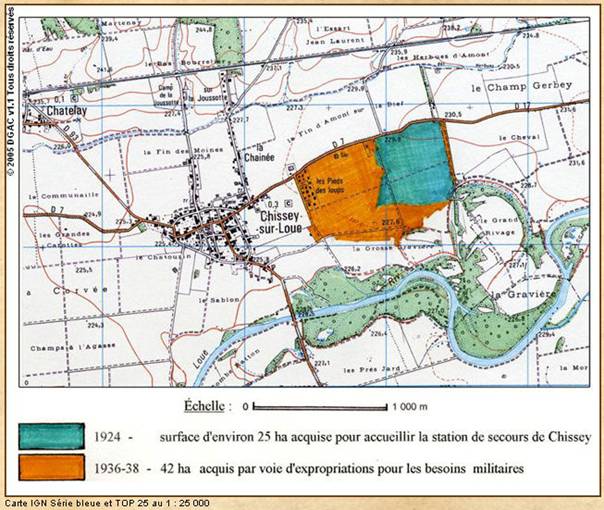
Les environs de Chissey
furent retenus dès 1921 pour accueillir un terrain de secours jalonnant la
route aérienne de Paris à Genève entre Dijon et Pontarlier.
D’une superficie de 27 ha, un premier
emplacement, aux portes du village, dut être abandonné compte tenu des
protestations soulevées en cours d’enquête d’utilité publique.
Éloigné de 600 m à l’est, le terrain
finalement retenu (aplat bleu sur la carte) put par contre être acquis à
l’amiable en 1924.
Resté jusque là
sans aménagements, le terrain de Chissey fit l’objet
en mai 1935 d’une décision d’extension immédiate afin qu'il puisse servir
"pour les besoins éventuels des opérations". Deux arrêtés
préfectoraux successifs ayant, dans un premier temps, autorisé l’occupation
temporaire des 42 ha concernés par cette extension (aplat orangé sur le plan),
leur acquisition par voie d’expropriation put intervenir entre septembre 1936
et juillet 1938, après que le président de la République ait, quinze jours
avant que n’interviennent les décrets-lois du 30 octobre 1935 déclaré celle-ci
d’utilité publique et d’urgence "pour le Service Militaire".
À la mobilisation, l’aérodrome
accueillit une compagnie de l’Air du dépôt de Dijon qui le rendit inutilisable
avant de l’évacuer.
Les Allemands n’occupèrent pas le
terrain mais le morcelèrent en parcelles d’environ 1 ha qu’ils obligèrent les
agriculteurs de Chissey à cultiver moyennant un prix
de fermage qui devait être réglé chaque année à la Kommandantur de Besançon.
Considérant que le terrain présentait
"un certain intérêt au point de vue aéronautique", le ministre des
Travaux publics et des Transports écarta, à La Libération, l’idée de sa
restitution définitive à l’agriculture mais prescrivit – malgré sa domanialité
publique – qu’il soit remis en culture par baux de longue durée.
La loi du 24 septembre 1948 portant
création de ressources nouvelles au profit du Trésor conduira cependant le même
ministre à décider, en accord avec le secrétaire d’État aux Forces armées
"Air", qu’il soit procédé à l’aliénation des terrains constituant
l’aérodrome.
Plusieurs années s’écouleront
toutefois avant qu’il ne soit plus question de l’aérodrome de Chissey.
Aérodrome de COULOMMIERS - VOISINS
(Seine-et-Marne)
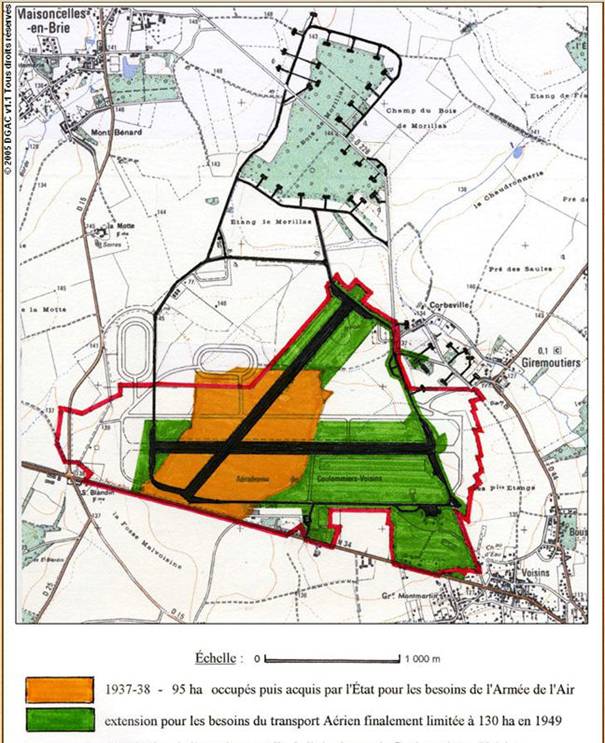
Totalisant 95 ha (aplat orangé sur la
carte), les parcelles ayant constitué l'emprise initiale de l'aérodrome de
Coulommiers - Voisins ont été occupées puis acquises par l'État en 1937 et 1938
après qu’une déclaration d'utilité publique ait été prononcée selon la
procédure d'urgence elle-même instituée par les décrets-lois du 30 octobre
1935.
Occupée par les Allemands, la
plate-forme vit ses limites repoussées par réquisitions plus ou moins
formalisées jusqu'à constituer un ensemble d'environ 500 ha sur lequel
l’occupant construisit deux pistes sécantes de respectivement 1 825 m et 2 000
m de longueur et 80 m de largeur, dont les extrémités étaient reliées par une
voie périphérique desservant elle-même au nord un réseau de dispersion (les
infrastructures allemandes sont indiquées en noir sur le plan).
Les forces alliées s'étant, après les
Allemands, établies quelque temps sur le plateau de Voisins, le terrain fut
finalement remis en novembre 1945 aux autorités françaises, lesquelles
donnèrent dès janvier 1946 une première définition des terrains qu'il convenait
de maintenir sous réquisition pour les besoins de l'aviation légère et du
transport aérien.
La décision prise peu après d'assigner
à Coulommiers - Voisins le rôle d'aérodrome de dégagement de l'aéroport d'Orly
conduisit à envisager de porter à 380 ha la surface à acquérir. La pression des
milieux agricoles fera toutefois que les acquisitions déclarées d'utilité
publique en septembre 1949 seront réduites à 130 ha (aplat vert sur le plan).
La superficie apportée par l'aérodrome de Coulommiers à l'ensemble désigné par
le décret du 20 avril 1949 comme constituant l'Aéroport de Paris se trouvera
donc établie à 95 ha + 130 ha.
C'est alors que le 21 décembre 1950
interviendra un autre décret déclarant d'utilité publique et urgents des
travaux militaires concernant notamment l'aérodrome de Coulommiers. Les
aménagements devant lui être apportés (allongement de la piste est-ouest,
construction d'un taxiway parallèle et de deux marguerites de dispersion…) se
traduiront par une nouvelle extension d'emprise de 179 ha qui, bien qu'acquise
sur des fonds O.T.A.N., ne fera l'objet d'aucun régime domanial particulier.
L'aérodrome de Coulommiers - Voisins
ayant cessé d'être considéré comme opérationnel par l'aviation militaire, ses
limites seront reculées sur leur position actuelle à la fin des années
soixante.
Plate-forme d'opérations du LUC - GRANDE-BASTIDE
(Var)
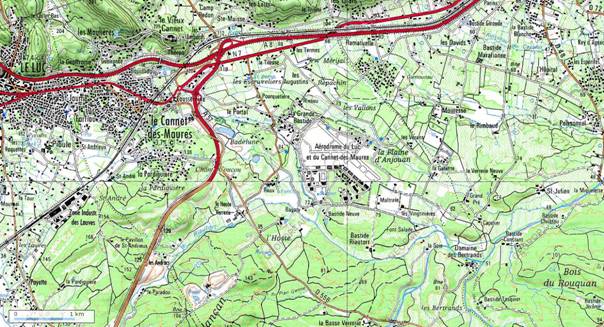
Parmi les aérodromes publics
provisoirement interdits à la circulation aérienne publique en raison du
mauvais état de la plate-forme par l’arrêté du 6 février 1947 figurait celui du
Luc - Grande-Bastide.
Ce terrain, implanté en fait sur la
commune voisine du Cannet-des-Maures, dont La Grande-Bastide constitue un
lieu-dit, n’avait jamais été mentionné sur les listes publiées par le Bulletin
de la Navigation Aérienne.
La fermeture à la circulation aérienne
publique du Luc - Grande-Bastide, prononcée à titre provisoire en 1947, sera de
courte durée, puisque l’arrêté du 30 mars 1953 le classera, sous le nom du Luc
- le Canet, dans les aérodromes publics contrôlés ou gardiennés.
L’aérodrome sera ensuite affecté,
toujours sous le nom du Luc - le Canet, par arrêté interministériel du 26
octobre 1963 :
·
à titre principal, au ministère des
Armées (Terre) pour les besoins de l’Ecole d’application de l’Aviation légère
de l’Armée de Terre,
·
à titre secondaire, au ministère des
Armées (Marine) pour les besoins de l’Aéronautique navale et au secrétariat
général à l’Aviation civile pour les besoins de l’Aviation légère et sportive.
Aérodrome de PERPIGNAN - LA SALANQUE
(Pyrénées-Orientales)
De création plus récente que celle de
la station frontière de Llabanère, le terrain de
secours de La Salanque n’apparut sur le Bulletin de la Navigation Aérienne
qu’en mars 1928.
Associé à une escale douanière
d’hydravions disposant elle-même d’une aire d’amerrissage de 1 200 m x 1 000 m
sur l’étang de Salses, le terrain de La Salanque conserva jusqu’en 1937 et sa
vocation civile et sa configuration d’origine (aplat bleu sur la carte).
La création d’un champ de tir dans la
région côtière s’étendant au nord du site de la Salanque fut alors accompagnée
de l’affectation de l’aérodrome à l’Armée de l’Air, de manière à permettre aux
formations effectuant leurs tirs d’application de disposer d’une plate-forme
d’atterrissage à proximité du lieu où elles devaient s’exercer.
Ce changement d’affectation fut
prononcé par un arrêté du ministre de l’Air en date du 4 novembre 1937, arrêté
qui, "en raison du caractère secret de l’opération", ne fut pas
publié par le Journal officiel.
Tandis que les hydravions des lignes
commerciales conservèrent la faculté d’utiliser le plan d’eau de l’étang comme
escale de secours, le terrain fut fermé à la circulation aérienne publique au
motif de la proximité de l’aérodrome d’État de Llabanère.
Le terrain devant pouvoir être utilisé
par tous les types d’appareils de l’Armée de l’Air, il fut également décidé que
sa surface d’emprise serait portée de 47 ha à 122 ha (aplat orangé sur la
carte).
L’objectif initial d’être prêts dès le
début de la campagne de tirs de 1938 n’ayant pu être atteint avec les outils
administratifs dont disposait le Génie pour l’Armée de Terre, l’appel aux
décrets-lois du 30 octobre 1935 fut prescrit par le ministre de l’Air en mai
1938.
L’expropriation des parcelles
nécessaires put alors être prononcée en octobre par ordonnance du président du
tribunal civil de Perpignan. Réunie en décembre 1939, la commission arbitrale
d’évaluation confirma les indemnités prévues par ladite ordonnance.
Interdit provisoirement à la
circulation aérienne publique par l’arrêté ministériel du 6 février 1947,
l’aérodrome de Perpignan - La Salanque ne réapparaîtra sur aucune des listes
annexées à celui du 30 mars 1953 abrogeant et remplaçant celui-ci.
Déclassé du domaine public en août
1962 de manière à permettre son affectation partielle à l’Armée de Terre,
"l’ancien aérodrome" de La Salanque n’en sera pas moins inscrit, en
novembre de la même année, sur la liste des aérodromes réservés à l’usage
exclusif des administrations de l’État annexée à l’arrêté ministériel du 23
novembre 1962.
Confirmé dans cette situation par
celui du 10 décembre 1964, il sera, le 15 juillet 1965, placé, pour une part
importante de son emprise, sous la main de l’Armée de Terre "pour les
besoins du casernement, de l’instruction et du logement".
L’autorité militaire, bien que
bénéficiaire exclusive du terrain, fit preuve de compréhension en accueillant
une petite activité d’aviation légère. Cette situation sera jugée peu
satisfaisante par l’Aviation civile à la fin des années quatre-vingts en raison
de :
-
l’intention d’aliénation annoncée par le ministre de la Défense,
- la nécessité de décharger
l’aérodrome de Rivesaltes (Llabanère) d’une partie de
son activité d’aviation générale.
Compliquée par la reconnaissance de la
domanialité sous-jacente Aviation civile de la plate-forme actée en 1983, cette
divergence d’intérêts semblait avoir sombré dans l’oubli au moment où fut
établie cette page d’atlas, de telle sorte qu’il a semblé préférable de pas
tenter de reporter sur le plan les limites actuelles de l’aérodrome...
Les
hommes du GC III/6 - Historique officiel du GC III/6 - Livre de marche
de la 5° - Livre de marche de la 6°
Page
d’accueil du site de François-Xavier BIBERT
Remerciements à la « Mission mémoire de
l’Aviation Civile »
pour son autorisation exceptionnelle de publication
et à Franck ROUMY
François-Xavier BIBERT – 05/2009